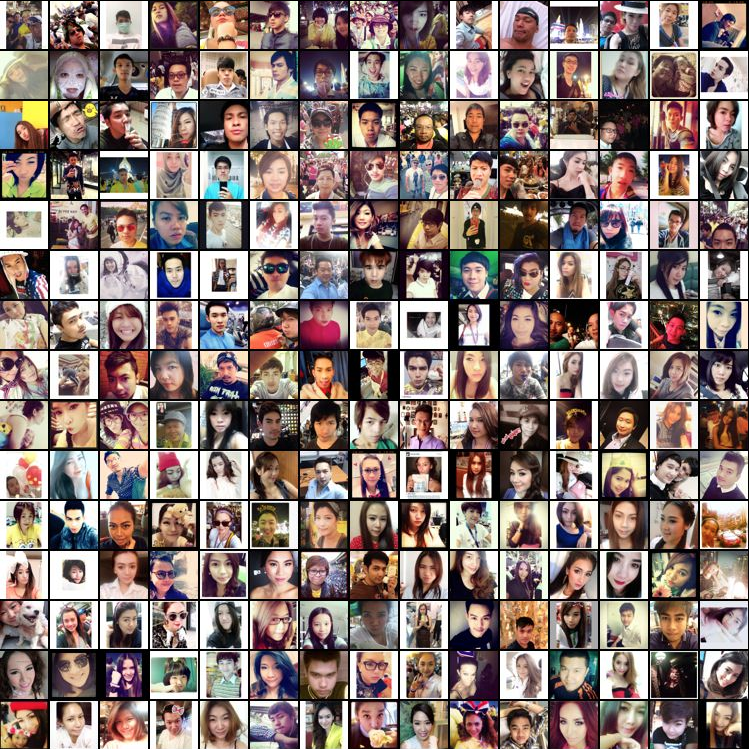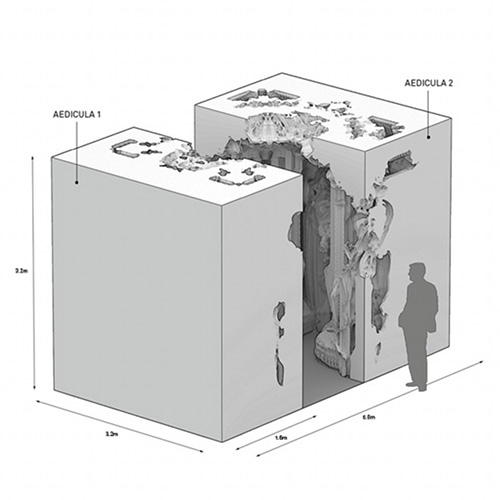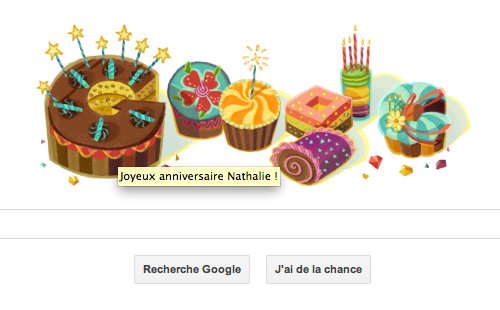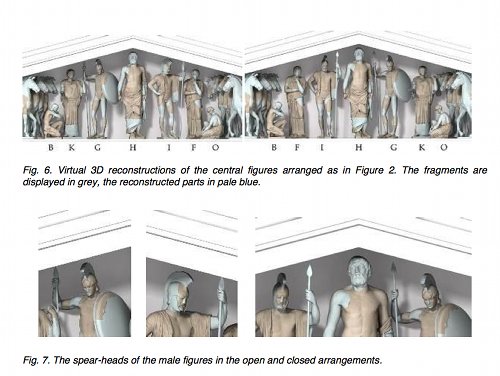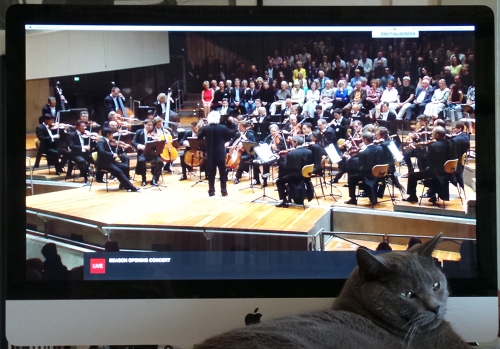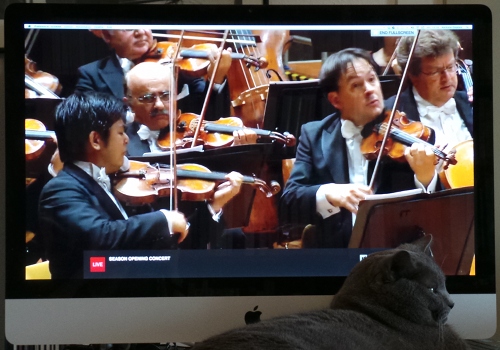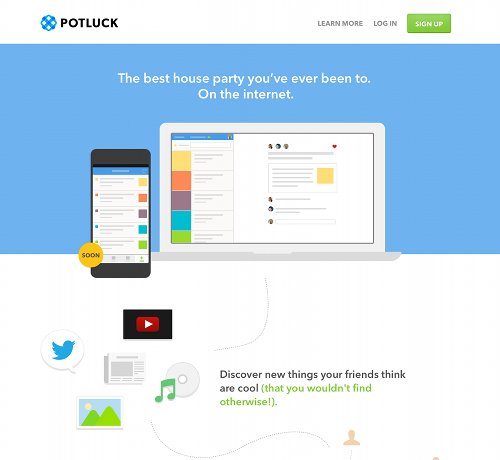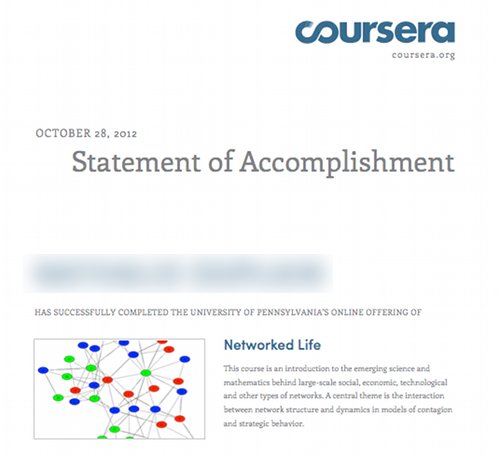Depuis la fin du 19ème siècle, les connaissances avaient explosé dans le monde occidental. L’alphabétisation de la société, le développement de la recherche scientifique ainsi que des progrès techniques dans l’imprimerie ont généré une augmentation des publications sous les formes les plus diverses : livres, revues, journaux. Le besoin de classer ces informations et d’en faciliter l’accès se fit sentir. Dès les années 30, des réflexions sur un système universel des connaissances, une sorte de préfiguration du World Wide Web, ont commencé à émerger dans le milieu des spécialistes de la documentation. En voici deux exemples.
Paul Otlet (1868- 1944) est un visionnaire à la fois auteur, entrepreneur, juriste et activiste belge. Il crée en 1905, avec Henri Lafontaine, le système de « classification décimale universelle » (CDU) sur la base de la classification de Dewey, ainsi que le standard de 125 sur 75 mm imposé aux fiches bibliographiques, toujours en vigueur dans les bibliothèques du monde entier. Paul Otlet met en place de nombreuses initiatives, toujours dans le but de réunir le savoir universel. Il les regroupe dans le Palais Mondial-Mundaneum de Bruxelles. Le Mundaneum comportait seize salles didactiques, un répertoire bibliographique comprenant douze millions de fiches, un musée de la Presse avec 200 000 spécimens de journaux du monde entier. Il a été fermé en 1934 pour libérer de la place et les collections ont été déménagées à plusieurs reprises. Ces collections se trouvent actuellement à Mons, dans le nouveau Mundaneum. Paul Otlet publie en 1934 un ouvrage qui fait toujours autorité dans le domaine de la documentation : le “Traité de documentation”. Dans cet ouvrage qui fait toujours autorité aujourd’hui, il pose les bases de la documentation moderne. A la fin de l’ouvrage, il envisage la mise en place d’un réseau universel d’information et de documentation, constitué d’entités nationales et locales qui, si elles sont hiérarchiquement organisées, n’en sont pas moins invitées à collaborer entre elles
[1]. Paul Otlet énumère également dans son traité ce qu’il considère comme les six étapes de la documentation. La sixième étape est celle de l’hyperdocumentation, correspondant au stade de l’hyperintelligence. Des documents correspondants aux divers sens (visuels, sonores, tactiles, etc.) sont enregistrés selon des technologies correspondantes et mêlés
[2]. Enfin, déjà à cette époque, grâce à sa connaissance des progrès technologiques, Paul Otlet anticipe des possibilités de consulter des documents depuis chez soi :
« On peut imaginer le télescope électrique, permettant de lire de chez soi des livres exposés dans la salle teleg des grandes bibliothèques, aux pages demandées d’avance. Ce sera le livre téléphoté
[3]»
Paul Otlet a posé les bases de la documentation moderne. Nombre de ses propositions sont encore utilisées aujourd’hui dans des bibliothèques du monde entier. Sa vision élargie de la documentation et sa connaissance des progrès techniques lui ont fait entrevoir ce qui constitue aujourd’hui Internet et notamment sa partie hypertextuelle, le WWW, non seulement dans ses aspects techniques, mais aussi organisationnel (réseau) et même philosophiques (hyperintelligence).
H. G. Wells (1866-1946) est un auteur britannique surtout connu pour ses romans de science fiction comme la Machine à explorer le temps (1895) ou la Guerre des mondes (1898). Il a aussi écrit des ouvrages de réflexions politiques et de vulgarisation scientifique. En 1937, il participe au Congrès Mondial de la Documentation Universelle
[4]. En 1939, il publie dans l’Encyclopédie française
[5] un texte intitulé « Rêverie sur un thème encyclopédique ». Dans ce texte, il relève que, malgré l’accroissement des connaissances, les encyclopédies sont toujours conçues comme celles du 18
ème siècle. Cependant les technologies modernes comme la radio, la photo, les microfilms, permettent d’assembler une collection de faits et d’idées de manière plus complète, succincte et accessible. Il émet l’idée d’une encyclopédie permanente mondiale qui serait mis à jour par un grand nombre de personnes. Cette encyclopédie irait au-delà d’un simple répertoire. Elle serait également accessible partout:
And not simply an index; the direct reproduction of the thing itself can be summoned to any properly prepared spot[6].
H. G. Wells voit aussi dans cette encyclopédie le moyen de sauver la mémoire humaine : désormais son contenu serait copié et réparti, si bien qu’il serait préservé des destructions
[7]. Enfin H. G. Wells considère qu’elle ne s’adresse pas seulement aux universitaires, mais également aux familles et aux grand public et qu’elle constituera un outil pour les enseignants. Il termine ce texte en soulignant qu’une telle initiative ouvrirait la voie à la paix du monde en réalisant l’unité des esprit

H. G. Wells en 1922
Paul Otlet participait lui aussi au Congrès Mondial de la Documentation Universelle. Nul doute que les idées des deux hommes sont très semblables. Pour eux, les nouvelles technologies ouvrent des perspectives nouvelles pour répondre au défi de l’augmentation des connaissances et pour les rendre facilement accessibles à chacun. L’organisation des connaissances doit être universelle, décentralisée et non limitée à un seul pays. Enfin tous deux voient un rapport entre cette mise à disposition des connaissances et l’avènement d’une ère nouvelle pour le monde où la paix règnerait grâce à un esprit humain unifié. Ils avaient entrevu les possibilités qu’Internet apporte aujourd’hui pour tous ceux qui souhaitent acquérir et mettre à disposition des connaissances. Le printemps arabe a aussi montré que l’accès facilité à des informations permet à des populations dans des régimes non démocratiques de prendre conscience de leur situation et de se soulever.
Bien avant qu’Internet ne connaisse un succès mondial, certaines personnes très en avance sur leur temps avaient exprimé les besoins auxquels le réseau mondial pourrait répondre.
[4] Paris 16-21 aout 1937
[5] Encyclopédie française. Tome 18, La civilisation écrite, dir. Par Julien Cain, Paris, 1939. Repris dans World Brain, 1938, sous le titre de “The Idea of a permanent World Encyclopedia”